Première partie : LA PÉNOMBRE
Lorsqu’il accède au trône en 1461, le pouvoir de Louis XI est très symbolique. Trente ans plus tôt, Jeanne d’Arc avait mené son père, le faible Charles VII à Reims pour y être sacré roi. Nous sommes alors à l’apogée du Moyen-âge et la France est aux mains de puissants Seigneurs au premier rang desquels les ducs de Bourgogne et de Bretagne. A sa mort en 1483, Louis XI laisse un pays unifié et puissant bénéficiant d’une administration centrale efficace.
En un mot, il sonne le glas du système féodal et montre la voie vers la monarchie absolue qui culminera sous Louis XIV. Les conditions sont réunies pour qu’advienne la Renaissance, véritable révolution des moeurs et des idées, dont la Réforme protestante.
En 1464, sur commission royale, furent élaborées les «Estimes», le premier recensement, néanmoins limité aux sujets imposables. Louis Soubeyran a relevé des Soubeyran dans plusieurs communes du Vivarais, l’Ardèche actuelle, et il est possible que plusieurs d’entre eux nous soient apparentés.
Soixante-dix ans plus tard, en 1534, la réforme est prêchée à Privas où elle se développera rapidement au point que la ville deviendra en 1598 l’une des places fortes concédée aux Protestants par l’édit de Nantes.
Nos ancêtres furent donc aux premières loges du mouvement Réformé, sans que nous sachions exactement la place qu’ils y tinrent.
Abraham Soubeyran naquit aux alentours de l’an 1600 à Chassagnes, hameau situé à 7 km de Privas en Vivarais, l’Ardèche actuelle. On peut raisonnablement penser que, devenu adolescent, il fut placé en apprentissage dans une chauchière (tannerie) sur l’Ouvèze ou le Charalon, deux ruisseaux du coin.
Né avec l’édit de Nantes, il eut probablement une enfance tranquille sous le règne de celui qui avait su réconcilier les français. Henry IV aidé de Sully, leur apporta dans les dernières années de son règne la paix nécessaire à la reconstruction d’un pays dévasté par les guerres de religion. Abraham, gamin d’une dizaine d’année, apprendra avec quelques jours de retard du à la distance, la nouvelle de l’assassinat de Henry IV en 1610, lequel laisse les caisses royales bien remplies et une situation économique saine.
Son fils, désormais Louis XIII, est âgé de neuf ans, tout comme notre Abraham à une paire d’année près. Mais les ambitieux, un instant muselés, vont ramener le pays sur la voie de l’incertitude.
Seconde partie : L’INCERTITUDE
Les choses vont se gâter à Privas à compter de 1620 et amener Abraham Soubeyran, âgé d’une vingtaine d’années, à s’exiler. Cette année-là, Paule de Chambaud, veuve du seigneur protestant de Privas, se remarie avec Claude de Hautefort, ancien ligueur, fils du chef des catholiques du Vivarais. Cela ne fut pas du goût, on s’en doute, de la faction protestante, d’autant que son chef Brisson s’était également porté candidat au mariage.
La guerre civile est localement relancée et en 1621, Brisson s’empare du château de Privas et en chasse son rival, non sans troubles, morts et dégâts pour les privadois
La même année, Abraham Soubeyran quitte Privas pour Montélimar. Il est légitime d’envisager une relation de cause à effet. Que fit-il entre 1621 et 1632, date de la première archive familiale qui nous est parvenue ? Probablement son métier de tanneur. A plusieurs reprises, les Consuls de Montélimar ont pris durant cette période des arrêtés d’expulsion visant les étrangers à la ville pour cause de guerre ou de peste. Nous n’avons pas connaissance qu’il en ait été victime
Après la chute de La Rochelle en 1628, l’armée royale entreprend la tournée des places fortes protestantes du Languedoc qui pour la plupart se rendent sans combattre. La ville de Privas, elle, résiste. Le siège, la prise et la destruction totale de Privas (et malheureusement de ses archives) furent actés en 1629.
Ces évènements ont été à l’évidence connus et commentés à Montélimar, à 30 km de là. Ce dut être une épreuve pour Abraham qui comptait probablement des connaissances et parents parmi les victimes. Le lien qui nous reliait aux Cévennes était coupé, et notre histoire familiale sera désormais tournée vers le Dauphiné.
Sauf l’éphémère guerre des camisards au 18ème siècle, les protestants ne prendront plus les armes pour défendre leur foi et devront encore attendre un siècle et demi pour que la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen leur rendent leur liberté de conscience.
Dans l’immédiat, à Montélimar, un autre péril allait mettre au second plan les rivalités religieuses et politiques : la peste. Ce fut la dernière grande épidémie que connut Montélimar, mais aussi l’une des plus meurtrières. Venue d’Italie, elle toucha la ville vers le milieu de 1629 et y tua en deux ans mille à quinze cent personnes, soit près de 20% de la population. Les malades étaient expulsés de la ville et se regroupaient dans les bois environnants où ils construisaient des huttes. Leurs chances de survie étaient bien entendu quasi-inexistantes. Puis, du fait de l’abandon des cultures durant deux ans, la population eût encore à faire face à la famine.
Abraham resta-t-il à Montélimar ou s’éloigna-t-il quelques temps comme beaucoup d’habitants ? On ne le sait. Toujours est-il qu’il en réchappa puisque nous le retrouvons, grâce à une archive familiale, effectuant une vente le 20 mars 1632 au profit du Sieur Mathieu COURBON, marchand gantier à Dieulefit
(voir l’archive familiale-achat Courbon).
Puis le ciel s’éclaircit enfin. Après ce fléau majeur, les mariages et les naissances connurent une importante recrudescence, phénomènes logiques pour combler le déficit démographique.
Abraham ne fit pas exception à la règle et convola en justes noces avec Sébastienne Béraud le 24 février 1633. (Voir le contrat de Mariage) L’année suivante, le 25 juin 1634, il reçoit sa lettre d’habitation qui en fait un citoyen à part entière de Montélimar.
(voir la Lettre d’Habitation)
Par ces deux actes majeurs, sa situation était stabilisée et les racines de la branche Soubeyran de notre famille mieux arrimées. Elle put dès lors prendre son essor.
troisième partie : L’ESSOR
En mars 1661, quand Louis XIV annonce que, désormais, il « gouvernera en personne » initiant un règne de 54 ans, Abraham Soubeyran est âgé d’une soixantaine d’années et a encore 13 ans à vivre. Depuis son établissement définitif à Montélimar, sa situation semble avoir bien prospéré. L’industrie de la tannerie y était à l’époque importante et la situation sociale des « corroyeurs » bonne.
Abraham s’établit dans une tannerie rue « Pées de Colas » qu’il tenait du Sieur Jean Mausson, oncle de son épouse. Il en acquit une seconde en 1645 rue des Aleyracs, puis une troisième en 1658 rue Puits de Guigard. Ces trois rues, proches les unes des autres dans le quartier des tanneurs, existent encore partiellement aujourd’hui.
Abraham 1er Soubeyran mourut le 14 novembre 1674 – un an après Molière – et fut enterré le lendemain dans le cimetière protestant de Montélimar. Il fut contemporain de trois rois et vécut sous le gouvernement de ministres aussi réputés que Sully, Richelieu, Mazarin ou Colbert.
Hormis le sien, on compte deux autres foyers Soubeyran à Montélimar, ceux de ses fils Mathieu et Barthélémy, notre ancêtre.
Mathieu habite avec sa famille dans la tannerie du Puits de Guigard que lui a donnée son père lors de son mariage. Un faisceau d’indices laissent à penser qu’ils se sont brouillés quelques années après le mariage de Mathieu. Et de fait, Abraham 1er a déshérité son ainé Mathieu au profit de son cadet Barthélémy, et Mathieu n’est pas présent aux obsèques de son père. (Voir le testament d’Abraham 1er)
Barthélémy au contraire habitait avec ses parents rue Pées de Colas. Il s’était marié trois ans plus tôt en 1671 avec Anne Sablon de qui il avait déjà deux enfants au décès de son père, Abraham (II) né en 1672, et Daniel qui mourra l’année suivante. Deux autres fils, Jean (1676) et Pierre (1678) complèteront la fratrie.
Barthélémy ne survivra que 5 ans à son père et mourra en 1679 à l’âge de 38 ans, laissant son épouse Anne avec 3 jeunes enfants.
Il ne saura pas qu’elle devra affronter quelques années plus tard, comme tous les protestants, les conséquences de l’Edit de Fontainebleau abrogeant en 1685 l’édit de Nantes.
Elle saura assurer la « régence » des biens jusqu’a ce que Abraham II soit en âge de reprendre le flambeau.
Ce sera l’objet de la saison 2 de la SagaSoub à laquelle nous travaillons et qui paraîtra … disons … un jour prochain !
Sources
- Louis Soubeyran, Essai historique et généalogique sur les Soubeyran de Montélimar et Dieulefit, Compte d’auteur, 1932
- Elie Renier : Histoire de Privas, Habauzit, Aubenas, 1941 à 1951 (4 tomes)
- A. Lacroix : Histoire de Montélimar, Chantemerle éditeur, Nyons, 1974
- Samuel Mours : L’église réformée de Montélimar, église réformée Montélimar, 1957
- Georges Duby : Histoire de la France, Larousse, 1970
- P.M. Kendall : Louis XI, Fayard, 1971
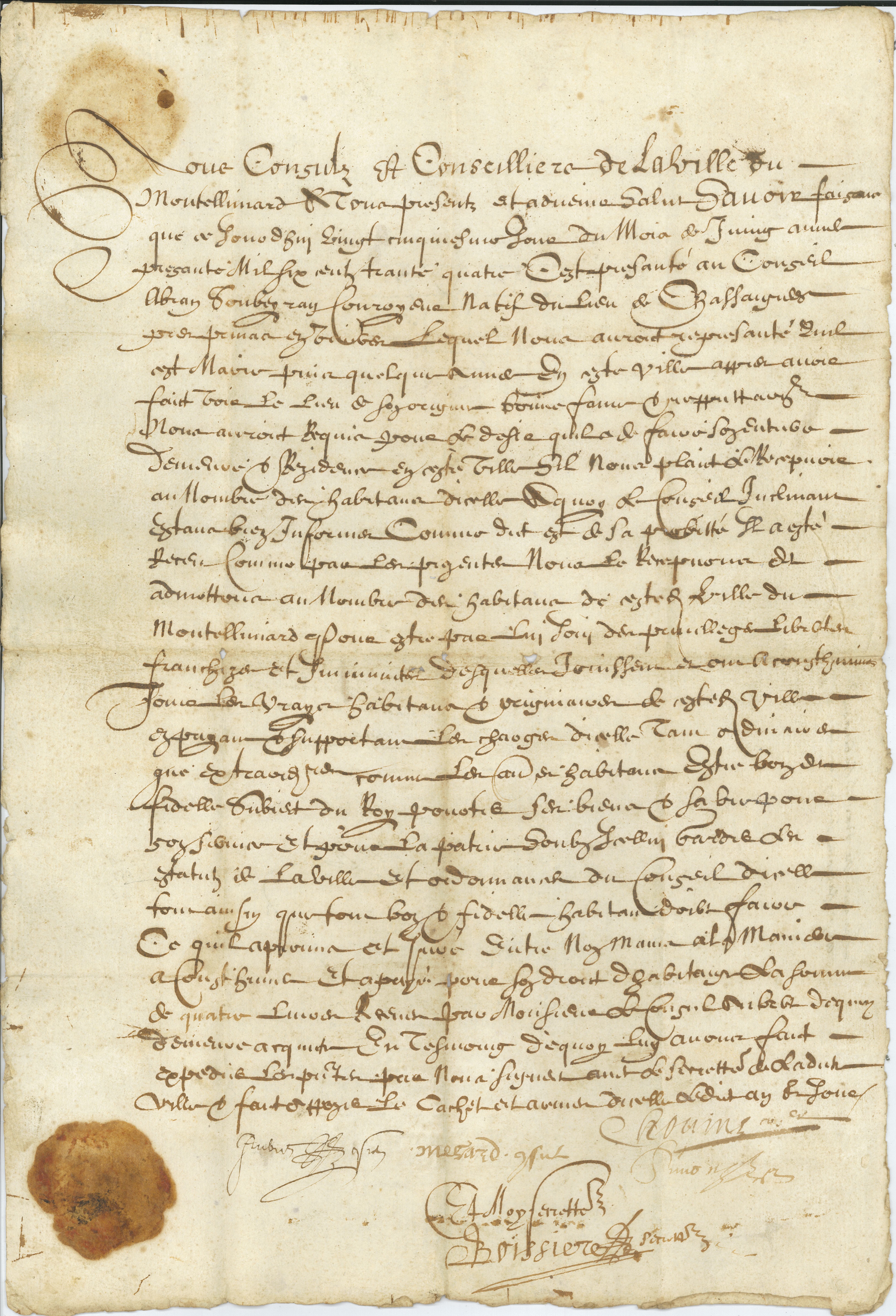
passionnant ! Bravo
L’histoire familiale dans la grande Histoire, merci papa!
Super, comme dit Liza, histoire familiale et grande histoire ce mélent bien.
Merci Lionel, j’ai mis un peu de temps pour lire mais, je l’ai fait d’une seule traite……! BRAVO !
Tres intéressant Lionel , on attend la suite avec impatience ! Quel travail!